I. Constats préalables : le brouillage contemporain du lien social
A. Corruption du langage
Le langage contemporain, sous l’effet des discours managériaux ou politiques, tend à perdre sa puissance de discernement. Le vocabulaire employé dans les entreprises, mais aussi dans les institutions publiques, se remplit de termes-valises : « valeurs », « projets », « visions », « performance », « culture », « management ». Ces mots, présentés comme neutres ou positifs, masquent souvent des rapports de pouvoir, de contrôle, d’exploitation. Ils deviennent des signaux d’appartenance plus que des instruments de pensée.
B. Colonisation du lien social par des pratiques gestionnaires
La rationalité gestionnaire, née dans le monde industriel, a progressivement colonisé tous les secteurs de la société : éducation, santé, recherche, secteur associatif, politique. Partout se déploient des dispositifs d’évaluation, de reporting, de performance. Le lien humain se réduit à des indicateurs. L’éthique devient un volet de la communication. La loyauté est exigée sous couvert d’engagement volontaire. Ce brouillage affaiblit notre capacité à distinguer ce qui relève d’une société libre de ce qui relève d’un encadrement doctrinaire.
II. Proposition de règle : quand une organisation devient-elle une secte ?
Ce n’est pas la doctrine ou l’objet d’une organisation qui fait sa nature, mais le type de lien qu’elle entretient avec ses membres.
A. Définition fonctionnelle de la secte
Une organisation devient sectaire lorsqu’elle remplit certaines conditions :
- Elle exige une loyauté inconditionnelle ;
- Elle enferme ses membres dans une bulle cognitive, où les réfutations extérieures sont discréditées ;
- Elle exploite ses membres : en temps, en argent, en énergie ;
- Elle désactive l’esprit critique, en le remplaçant par une rhétorique de la cause, du sens, de la mission.
B. Une entreprise, un parti, une ONG peuvent être des sectes
On suit un programme, une ligne, un leader. On s’investit corps et âme. Puis on s’interdit de douter. Toute sortie devient une désertion. Ce modèle sectaire peut prendre la forme d’un mouvement politique, d’une équipe projet, d’un collectif militant, d’une start-up.
La forme juridique (société, association, église) ne garantit rien. Ce qui compte, c’est la nature du lien.
III. Secta, societas, et l’hérésie comme choix
A. Retour au latin : sequor, socius, secta, societas
Dans la Rome ancienne, le socius est celui qui chemine avec vous. La societas est l’ensemble des compagnons d’alliance, ceux qui participent à une même cause, à un même monde. La secta, elle, désigne la voie suivie, l’école choisie (sequor : je suis). Elle n’est pas négative. Un épicurien, un stoïcien, un pythagoricien : chacun appartient à une secte.
B. L’hérésie : le choix libre d’une autre voie
Le mot hairesis, en grec, signifie d’abord choix. L’hérétique, c’est celui qui choisit autre chose que la doctrine dominante. Il ne s’agit pas d’erreur, mais de dissidence. Là où la société laisse place à la pluralité, la secte réclame l’unanimité. L’hérésie y devient insupportable, car elle menace l’identité close du groupe.
IV. Et vous, dans quoi êtes-vous embarqué ?
A. Êtes-vous dans une société, ou dans une secte ?
- Avez-vous le droit d’objecter sans être marginalisé ?
- Pouvez-vous remettre en question la doctrine commune sans être traité d’ennemi ?
- Le groupe vous élève-t-il ou vous instrumentalise-t-il ?
- La sortie est-elle possible, et honorable ?
B. Et cela vous convient-il ?
Il ne s’agit pas d’accuser, mais de discerner. Peut-être certains trouvent-ils dans une secte la ferveur (ou la voie) qu’ils ne trouvent plus dans la société. Peut-être d’autres, par conformisme, demeurent dans une société devenue sectaire. La question n’est pas morale. Elle est existentielle : avez-vous choisi la voie que vous suivez ?

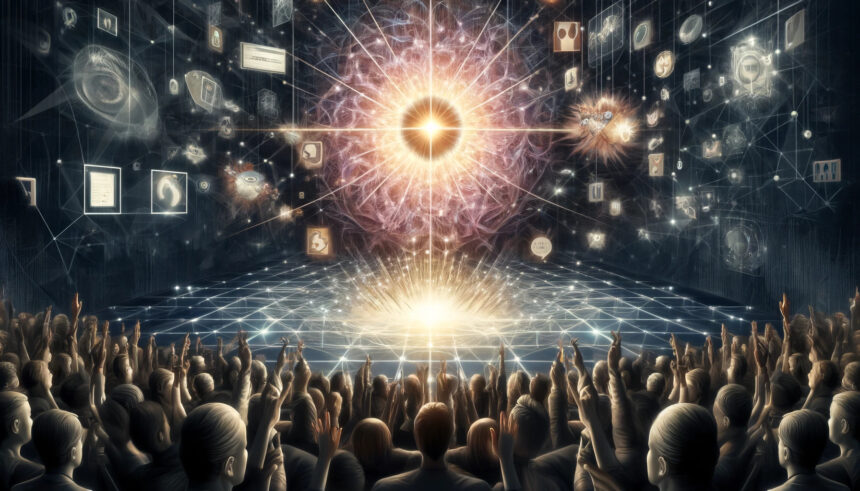
Laisser un commentaire