Dans les organisations traditionnelles, les relations interpersonnelles s’inscrivent dans un régime d’asymétrie amicale. Le lien hiérarchique, tout en étant inégalitaire, repose sur une reconnaissance mutuelle de rôles : le supérieur attend loyauté et efficacité ; le subordonné, protection, accompagnement, et reconnaissance. Cette structure, décrite notamment par Michel Crozier dans son analyse du « système bureaucratique » (Le phénomène bureaucratique, 1963), a longtemps constitué le socle implicite des relations en entreprise.
Cependant, depuis une vingtaine d’années, un changement profond s’amorce. L’aspiration contemporaine à l’horizontalité, largement relayée par les discours managériaux et les cabinets de conseil, vise à promouvoir des relations plus symétriques, fondées sur la coopération, la responsabilité partagée et l’auto-détermination. Cette évolution est manifeste dans la multiplication des structures dites « libérées » (Laloux, Reinventing Organizations, 2014) ou dans l’adoption du vocabulaire agile, inspiré du développement logiciel mais appliqué à l’ensemble de la vie d’entreprise.
Néanmoins, cette volonté de symétrisation relationnelle entre individus — souvent perçue comme une condition de l’engagement et de la performance — ne va pas sans tensions. Car toutes les personnes n’entrent pas avec les mêmes attentes dans ces nouveaux cadres, ni avec les mêmes représentations de ce qu’est une relation professionnelle. La recherche d’une symétrie dans les relations peut être mal reçue, perçue comme une tentative de transgression ou d’usurpation de position. Elle génère alors, paradoxalement, des conflits, voire des dynamiques hostiles.
Pour éclairer ces transformations, il peut être utile de distinguer les types de relations entre individus selon deux axes :
- L’axe de la disposition affective : amicale ou hostile.
- L’axe de la structure : symétrique ou asymétrique.
Ce croisement donne naissance à un tableau à quatre cases :
| Symétrique | Asymétrique | |
|---|---|---|
| Amicale | Camaraderie, coopération entre pairs | Paternalisme bienveillant, mentorat |
| Hostile | Rivalité, compétition agressive | Autoritarisme, harcèlement, mépris |
Ces quatre modalités ne sont pas figées : une relation peut glisser de l’une à l’autre selon les événements, les contextes, ou les décisions organisationnelles. Mais ce cadre permet de comprendre certaines dynamiques de tension :
- Lorsqu’une relation asymétrique et amicale (par exemple, un management bienveillant) tente d’évoluer vers une symétrie, elle risque d’être perçue comme une perte de statut par le supérieur ou comme une obligation d’engagement accru par le subordonné.
- Inversement, la volonté d’égalisation peut être vécue comme une mise en compétition entre égaux, glissant vers une hostilité symétrique (compétition de type startup, voire individualisme forcené).
La transformation du lien hiérarchique en relation symétrique repose donc sur un équilibre subtil. Trop brutalement imposée, elle désorganise les repères. Trop timidement, elle laisse en place des asymétries de fait qui deviennent sources de frustration.
Le rôle des directions des ressources humaines devient ici central : il ne s’agit plus seulement de garantir des conditions de travail équitables, mais d’accompagner des transformations profondes dans les imaginaires relationnels. Cela suppose une capacité d’écoute, une maîtrise des modèles d’analyse des relations humaines, et une vigilance à ne pas reconduire, sous des formes nouvelles, des rapports hostiles déguisés en symétrie.
On pourrait convoquer ici la distinction de Boltanski et Thévenot dans De la justification (1991), entre différents « mondes » (civique, domestique, industriel, etc.) : chacun implique des formes différentes de hiérarchie et de légitimité. Les tensions relationnelles naissent souvent du chevauchement ou de la contradiction entre ces registres. Là où le monde domestique valorise la fidélité et la protection (forme asymétrique et amicale), le monde civique réclame égalité et transparence (symétrique et amical), tandis que le monde de la compétition libérale valorise la réussite individuelle (symétrie hostile).
Ainsi, les relations en entreprise ne peuvent se comprendre qu’en tenant compte à la fois des structures, des affects, et des représentations symboliques. Leur évolution contemporaine est porteuse d’espoirs d’émancipation, mais aussi de nouveaux risques de malentendus et de tensions, que les RH doivent savoir anticiper, diagnostiquer, et réguler avec finesse.

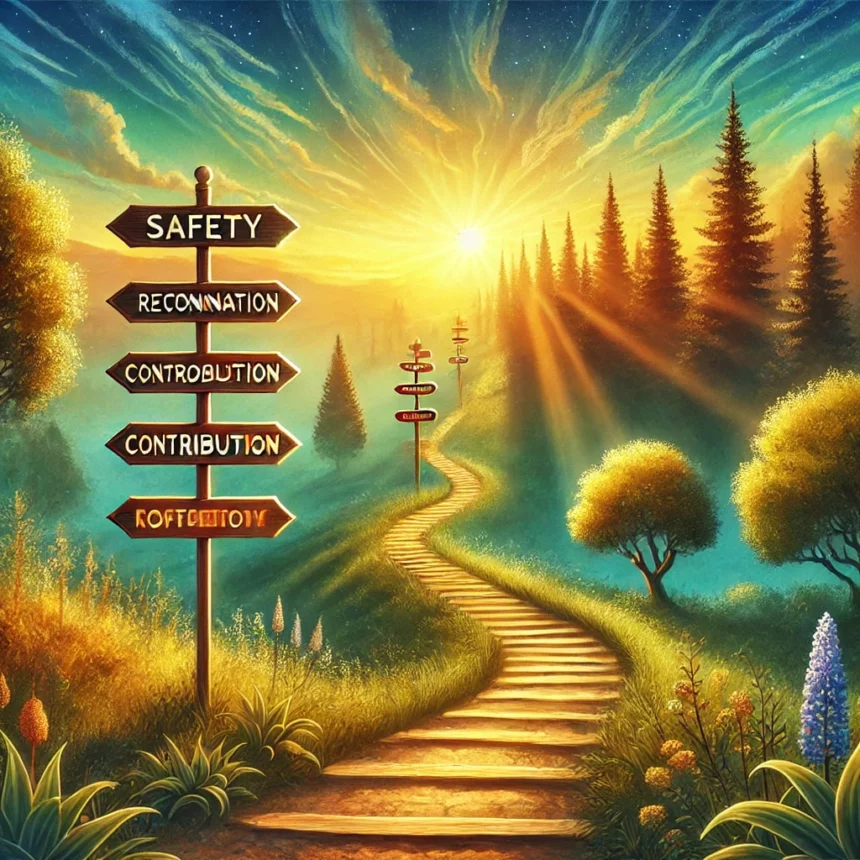
Laisser un commentaire